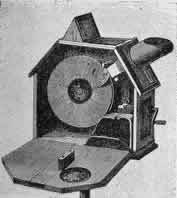
Certains des premiers spectateurs du Cinématographe, émerveillés par le spectacle proposé, regrettaient pourtant qu’il porte un nom si compliqué. Louis Lumière lui-même s’en serait excusé lors d’une séance. Mais si les frères lyonnais n’avaient pas remporté la course aux brevets, comment nommerait-on le 7e art ? Les machines concurrentes du Cinématographe s’appelaient : Cinographoscope, Aléthorama, Kinétoscope, Électrotachyscope, Mutoscope, Eidoloscope, Bioscope, Vitascope, Phantoscope… (liste non exhaustive – il en existe une plus complète avec des précisions sur les appareils, en ligne ici)
Quelques recherches étymologiques permettront de préciser comment ces mots ont été formés. Est-il toujours question d’écriture et de mouvement ? Sur quels autres aspects de l’invention ces noms mettent-ils l’accent ?
Réalisation d'une vue documentaire
Réaliser un film à la manière des frères Lumière est une expérience aussi accessible que formatrice.
On conseille de se focaliser sur la réalisation du vues documentaires. Les Lumière ont certes réalisé des fictions, mais l’exercice est tout autre et ne permet pas aussi bien de se confronter à l’observation du réel.
Équipement
Un téléphone ou un appareil photo suffit pour la prise de vues, de préférence stabilisé pour éviter un effet de caméra portée peu conforme aux vues des premiers opérateurs.
Préparation
Option A : on se contente d’indiquer les contraintes aux élèves : filmer un plan de 50 secondes, sans bouger la caméra. Cette option est à éviter si on ne peut pas faire deux phases de tournage (voir ci-dessous).
Option B : on montre des vues Lumière aux élèves en les sensibilisant au travail sur le cadre, la profondeur de champ, le hors-champ, la durée. On relève des thèmes récurrents (le travail, la vie quotidienne, les événements…) pour leur donner des idées de sujet. On leur indique ensuite les contraintes de réalisation : filmer un plan de 50 secondes, sans bouger la caméra.
Tournage
On lance une période de tournage pendant laquelle les élèves tournent en autonomie autant de vues qu’ils le souhaitent. La réalisation peut se faire en petits groupes ou individuellement suivant le matériel dont disposent les élèves.
Échange (et second tournage)
Parmi toutes les vues tournées, chaque élève sélectionne celles qu’ils souhaitent montrer au reste de la classe. Le visionnage des vues sélectionnées permet d’échanger sur les conditions de tournage, de voir si les contraintes ont suscité des blocages ou stimulé la créativité.
Si possible, on lance une deuxième phase de tournage qui permet de mettre à profit ces échanges.
Pour voir des vues Lumière réalisés par des lycéens et apprentis de la région Centre.
Cette expérience peut être menée avec l’appui de Ciclic, en faisant venir un intervenant réalisateur. En savoir plus.
S.G.